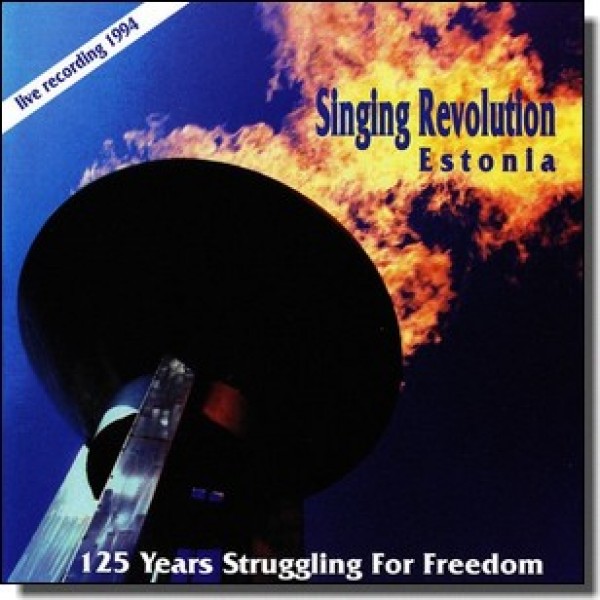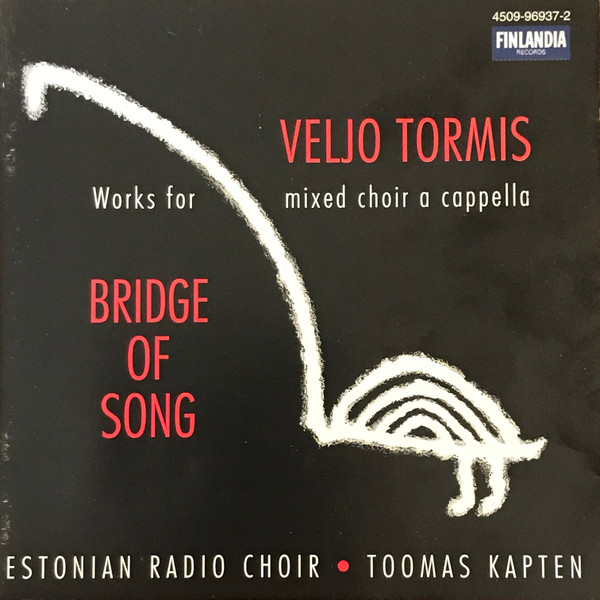Les festivals de chant – la voie vers l’indépendance
 Place de la chanson de Tallinn, une photo d’Anne-Sophie De Sutter (en creative commons, via flickr)
Place de la chanson de Tallinn, une photo d’Anne-Sophie De Sutter (en creative commons, via flickr)
Les festivals de chant sont nés au 19e siècle, en 1869 à Tartu, et ont eu un rôle important dans le cours de l’histoire des pays baltes. À cette époque, l’Estonie était une province de l’Empire russe et les propriétaires terriens allemands contrôlaient la paysannerie. Cette situation a provoqué un sentiment de conscience nationale auprès des Estoniens qui ont voulu par le biais de ces festivals mettre en avant leur propre identité et revendiquer un futur meilleur et indépendant. Cette manifestation a été organisée six fois entre 1879 et 1910, puis tous les cinq ans après l’indépendance. A partir de 1928, elle a déménagé à Tallinn et une scène en plein air a été aménagée en 1960.
Ironiquement, c’est à la période staliniste que ces festivals de chant ont été les plus soutenus : la politique culturelle de l’époque avait décidé que les traditions musicales baltes étaient dépassées, inexistantes, et qu’elles devaient être remplacées par du chant en chœur suivant les préceptes émis par l’état. Le gouvernement soviétique a alors encouragé la formation de groupes folkloriques comme le chœur seto Leïko de Värska, ou encore Leegajus et Hellero, aux costumes traditionnels idéalisés, jouant des instruments standardisés et interprétant des chants aux harmonies bien plus proches de la musique classique que de celle des villages. Certains musiciens ont suivi ces règles, composant des chants vantant par exemple la collectivisation.
Le régime a associé ces festivals à des commémorations communistes et a supervisé de près les artistes qui montaient sur scène et interprétaient des chants de propagande mais les Estoniens ont toujours réussi à insérer au moins une chanson qui donnait de l’espoir et un sentiment d’unité. « Mu isamaa on minu arm » (Ma patrie est mon amour) est un exemple. Gustav Ernesaks a composé en 1944 une nouvelle musique pour un texte de Lydia Koidula, datant de 1867, et le morceau avait été interprété pour la première fois à un festival en 1947. Interdit par la suite par le régime soviétique, il a pourtant été chanté à nouveau lors de ces festivals au début des années 1960. Les groupes et chœurs nationaux ont toujours en premier lieu représenté le peuple, même si c’était de manière très limitée.
L’indépendance des pays baltes en 1991 a été amenée par une révolution chantée qui a duré plus de deux ans, avec divers actes de protestation et de désobéissance. En mai 1988, Alo Mattiisen présente pour la première fois ses « Cinq Chansons Patriotiques » au Festival Pop de Tartu et en juin, les Estoniens se rassemblent spontanément à Tallinn sur la Place de la chanson où sont organisés régulièrement des festivals et commencent à écouter et interpréter des chants patriotiques. En août 1989 se forme une chaîne humaine de deux millions de personnes entre Tallinn, Riga et Vilnius. Ces événements, et d’autres encore, ont finalement mené à l’indépendance.
Depuis, ces festivals ont toujours lieu régulièrement, proposant un répertoire varié de chants traditionnels et de pièces composées pour l’occasion. Tout le monde peut participer et il est impressionnant de voir le nombre de personnes qui chantent en chœur. Un compositeur connu dans ce répertoire est Veljo Tormis (1930). Il travaille aux franges de la musique classique et des traditions populaires. Il a combiné des airs anciens, tout particulièrement les chants runiques, avec des techniques de composition modernes, issues du monde classique contemporain. Il s’est intéressé aux langues fenniques de la famille finno-ougrienne en voie de disparition comme le vote, l’ingrien, le vepse et le live ou livonien. (ASDS)