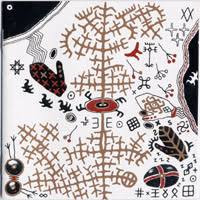Traditions du passé : chants runiques et musiques à danser
Chanson traditionnelle , Polyphonie , Polyphonie vocale , Musique traditionnelle , Choeur
13 janvier 2025
 Célébration traditionnelle avec danse et chant, une photo d’Olev Mihkelmaa (via flickr, en creative commons)
Célébration traditionnelle avec danse et chant, une photo d’Olev Mihkelmaa (via flickr, en creative commons)
Les musiques traditionnelles estoniennes ne sont plus pratiquées aujourd’hui dans le cadre de la vie quotidienne comme dans le passé mais elles inspirent les artistes actuels qui les adaptent et les interprètent sur scène. Il y a une tradition ancienne de chants runiques d’inspiration finnoise, remplacés progressivement au 18e siècle par des chants plus rythmés et des musiques à danser, ainsi que des romances russes. Il existe également quelques instruments locaux spécifiques. Une grande période de collectage a eu lieu durant la seconde moitié du 19e siècle mais aussi pendant les années 1960 et 70, en pleine période soviétique. Des ethnomusicologues et chercheurs ont alors parcouru les villages pour découvrir les traditions locales anciennes. Entre 1956 et 1965, Herbert Tampere a supervisé la publication des cinq volumes du Eesti Rahvalaule Viisidega (Chansons populaires estoniennes avec partitions), accompagnés de disques qui sont sortis en 1967.
Les chants runiques sont nommés Regilaul en Estonie et ils possèdent une forme similaire à ceux qui existent en Finlande. Beaucoup de textes ont été collectés. Ceux-ci ont pour la plupart été composés par des femmes et offrent un point de vue féminin sur la vie quotidienne : travail, rituels, sortilèges, ballades et mythologie. Ils ont tendance à exprimer la tristesse ou les réalités difficiles de la vie plutôt que la joie et l’amour et certains sont supposés avoir des pouvoirs magiques, influençant les phénomènes naturels et guérissant les maladies. Ils ont été rassemblés en épopée nationale par le folkloriste F. Reinhold Kreutzwald (1803-82) et publiés dans les années 1860 sous le titre de Kalevipoeg.
Ces chants runiques n’ont quasi plus été interprétés à partir du début du 20e siècle, mais une forme particulière a cependant survécu dans quelques régions, notamment celle de Setomaa, près de la frontière russe, et sur l’île de Kihnu. Le peuple seto parle l’estonien, langue qui leur a été imposée durant l’entre-deux-guerres, mais pratique la religion orthodoxe russe, ce qui les a isolés à la fois des Estoniens protestants et des Russes qui parlaient une autre langue. Ils se considèrent cependant comme pleinement Estoniens depuis la période soviétique. Leur culture a été mieux préservée que dans le reste du pays.
Les chants leelo des Setos sont interprétés selon le monde responsorial, alternant une voix en solo et celles d’un chœur, qui répète en polyphonie le texte invoqué (et souvent composé) par la première voix, sur des mélodies aux formes traditionnelles prédéfinies. Comme ces chants étaient interprétés en extérieur, les voix sont fortes et aigues. La période soviétique a forcé les habitants de la région à se rassembler dans les Maisons de la culture pour former des ensembles amateurs. Certains groupes ont alors reçu la possibilité de se produire à l’étranger, comme l’Ensemble Leïko, fondé en 1964 à Värska. Il interprétait en concert des chants traditionnels nationaux et influencés par les formes folkloriques de prédilection du gouvernement soviétique mais continuait à chanter les traditions lors des fêtes villageoises et familiales de la région, les chanteuses plus âgées transmettant leur art aux plus jeunes. Ces groupes sont essentiellement composés de femmes, le chant étant considéré comme une activité féminine, mais il existe aussi des chœurs d’hommes ou mixtes.
Le répertoire est lié à la vie quotidienne et comprend des chants de travail, de mariage, de funérailles. Ce qui devait être exprimé était chanté, la vie en général ou un événement particulier. Comme en Russie toute proche, les chants de noces sont les plus singuliers. Les cérémonies durent trois jours et la musique est présente à chaque étape, de la maison de la jeune fille à celle du couple marié, incluant notamment des chants de lamentation marquant la fin de la vie de jeune fille et sa renaissance en tant que femme mariée.
Ailleurs, les chants runiques ont progressivement été remplacés par des musiques de danse, mettant en avant divers instruments. C’étaient les hommes qui les jouaient. Les plus simples étaient fabriqués à la maison tandis que les plus élaborés étaient achetés. Certains instruments à vent étaient liés à la vie pastorale, comme des cornes d’animaux kajapasun, des trompettes en bois, des flûtes en saule vilepill et des cornemuses, comme le torupill qui accompagne des danses rituelles voortants. Des musiciens actuels les réutilisent dans de nouvelles compositions. Le répertoire des musiques à danser était dominé par les violons, accordéons et concertinas mais aussi par le kannel qui accompagnait les polkas, entre autres. Il s’agit d’une version estonienne de la cithare baltique. Il ressemble au kantele finnois mais possède six cordes plutôt que cinq. L’instrument a survécu même s’il n’était plus joué au 20e siècle. Des artistes finlandais de kantele comme Hannu Saha et Antti Kettunen ont ravivé l’attention autour de cette famille d’instruments et des musiciens estoniens comme Tuule Kann l’ont également mis en avant. La région de Seto possède sa propre version du kannel. (ASDS)