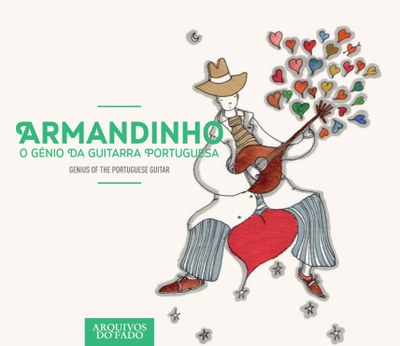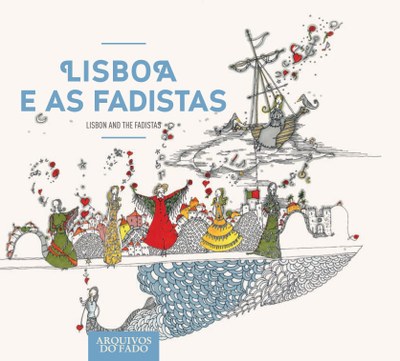Le fado – un style lisboète né au 19e siècle
Guitare , Chanson traditionnelle , Portugal , Fado , Lisbonne
05 juillet 2023
 O fado, une peinture de José Malhoa (via wikicommons)
O fado, une peinture de José Malhoa (via wikicommons)
Accompagnés de guitare portugaise, les artistes du fado interprètent des morceaux qui sont d’une grande mélancolie mais qui peuvent aussi être très radieux. En dehors du Portugal, c’est surtout cette tristesse, cette saudade qui est connue. C’est un concept un peu imprécis, un sentiment indéfini entre langueur et tristesse, le souvenir d’un bonheur perdu et cet espoir d’un retour magique à ce moment heureux. Cette délectation de l’absence et de la morosité n’est pas le propre des Portugais et se retrouve plus largement dans le monde lusophone mais aussi dans l’enka japonais, le tezeta éthiopien ou encore le tango finlandais. Un bon chanteur de fado sait comment transmettre cette saudade, cette émotion pure qui garde en elle des mystères.
Au fil des décennies, la forme du fado a évolué : certaines caractéristiques sont présentes depuis son développement initial mais son mode d’interprétation, son répertoire et son contexte social se sont modifiés. Ses origines sont controversées. Il y a probablement eu une juxtaposition d’influences très diverses qui se sont retrouvées présentes au même moment – au début du 19e siècle – dans la ville de Lisbonne. D’un côté, il y a les chansons de salon locales, les modinha, ainsi que divers styles du répertoire rural. D’un autre, on retrouve des sources afro-brésiliennes comme les danses lundum ou fofa. « Fado », un mot qui viendrait du latin « fatum », signifiant « destin », est également le nom d’une danse brésilienne qui subsiste dans les régions rurales autour de Rio de Janeiro.
Ce fado portugais des origines était accompagné d’une danse dont les mouvements et gestes seront très vite, dès la seconde moitié du 19e siècle, jugés obscènes. Dès les années 1830, il rencontre la guitarra, la guitare portugaise à la caisse piriforme et au vibrato prononcé, remplaçant progressivement les anciennes violas (le nom portugais de la guitare classique). Au duo chant-guitarra se sont ajoutés au fil du temps une ou deux violas et une viola baixo (guitare basse).
C’est un style lisboète, des quartiers populaires – l’Alfama et Mouraria – où les bars et bordels étaient nombreux. Marins, travailleurs du port, trafiquants en tous genres, migrants des zones rurales, prostituées mais aussi des aristocrates bohêmes et des étudiants attirés par le côté exotique du quartier se rejoignaient là pour écouter les chansons. Les textes racontaient les histoires des gens démunis et illettrés de ces parties de la ville, ce qui explique certains thèmes liés à la vie des bas-fonds et aux mœurs dissolues. Ils parlent encore aujourd’hui de malheur, d’abnégation, de sacrifice (souvent personnifié dans la figure de l’enfant), mais aussi d’amour.
Au fil des décennies, le fado s’est développé, prenant au fur et à mesure une forme précise, et il a essaimé dans tous les milieux. Au début du 20e siècle, il est écouté partout à Lisbonne, autant par l’élite qui invite les artistes dans les salons privés que par les classes populaires qui se rassemblent dans les associations locales et lors des fêtes religieuses, ainsi que lors des corridas. Les classes moyennes et la bourgeoisie sont les dernières à adopter le style qui sera dès lors joué dans les théâtres et les brasseries.
1926 voit l’arrivée de l’Estado Novo, le régime totalitaire qui perdurera jusque 1974, et dès 1927, des lois réglementent les performances de fado : les paroles doivent être approuvées officiellement et les salles de spectacle ainsi que les artistes doivent obtenir une licence spéciale, ce qui a entraîné la disparation de beaucoup de lieux d’écoute, tandis que d’autres se sont créés, les casas típicas où on peut aussi manger et boire. Des codes se mettent en place : la salle est très sombre, l’artiste est habillé en noir, le public doit garder le silence, ce qui accentue le côté triste et nostalgique. Les chanteurs sont devenus des professionnels, avec des contrats, mais un monde souterrain du fado a continué à exister. Suite à ces obligations, le fado a perdu son côté instantané et spontané. La forme s’est également fixée à cause des enregistrements sur 78 tours et de la radio qui ont réduit la durée des morceaux, et qui ont donc rendu impossible son côté improvisé.
Parmi les artistes qui ont enregistré lors des premières décennies du 20e siècle, il faut citer le guitariste Armandinho (1891-1976) et les chanteuses Maria Alice (1904-96) qui a fait carrière dans les années 1930 et 40, Ercília Costa (1902-85) qui a commencé sa carrière en 1927 et a enregistré un dernier album en 1972 et Hermínia Silva (1907-93), également actrice dans le théâtre de vaudeville et au cinéma. (ASDS)
À Médiathèque Nouvelle
-
MU0399 Armandinho, O Génio Da Guitarra Portuguesa Tradisom, 1928-1929.
-
MU0147 Lisboa E As Fadistas Tradisom.
-
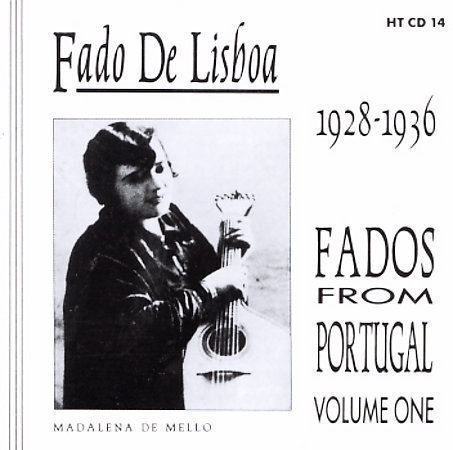 MU0191 Fado De Lisboa: Fados From Portugal, Volume One 1928-1936 Heritage, 1928-1936.
MU0191 Fado De Lisboa: Fados From Portugal, Volume One 1928-1936 Heritage, 1928-1936. -
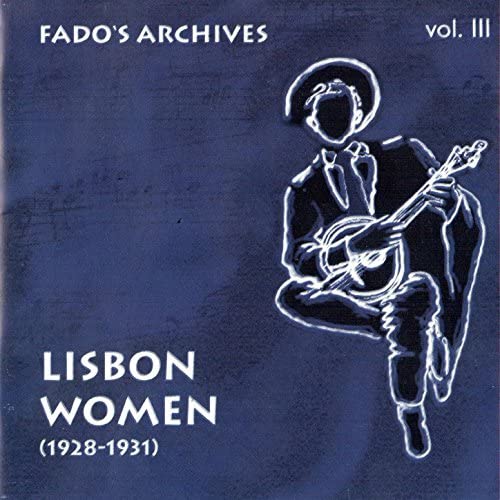 MU0202 Fado's Archives Vol. III: Lisbon Women (1928-1931) Heritage, 1994. Enregistrement 1928-1931.
MU0202 Fado's Archives Vol. III: Lisbon Women (1928-1931) Heritage, 1994. Enregistrement 1928-1931. -
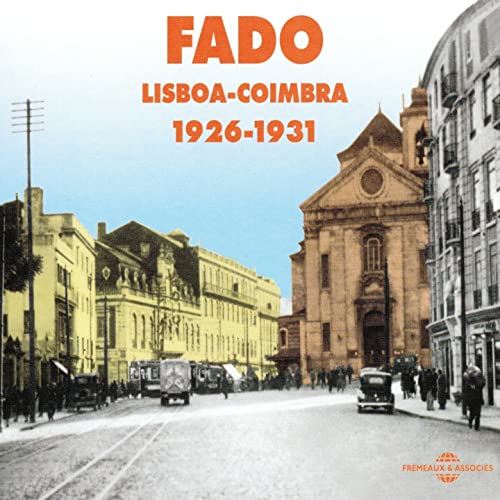 MU0209 Fado: Lisboa-Coimbra 1926-1931 Fremeaux & Associes, 1998. Enregistrement 1926-1931.
MU0209 Fado: Lisboa-Coimbra 1926-1931 Fremeaux & Associes, 1998. Enregistrement 1926-1931. -
 MU0970 Ercilia Costa, Fado's Archives Vol. Vi: Ercilia Costa Com Armandinho (1930) Heritage, 1996. Enregistrement 1930.
MU0970 Ercilia Costa, Fado's Archives Vol. Vi: Ercilia Costa Com Armandinho (1930) Heritage, 1996. Enregistrement 1930. -
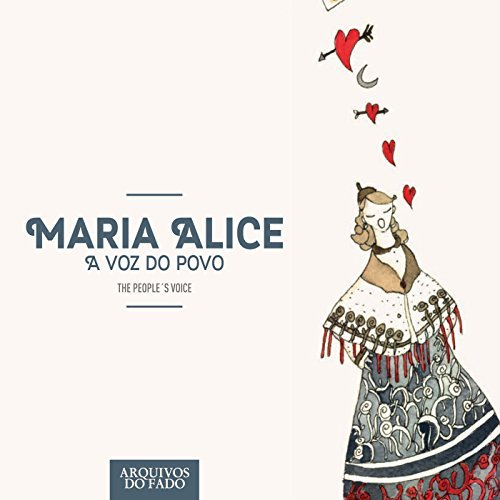 MU1620 Maria Alice, A Voz Do Povo Tradisom, 1929-1931.
MU1620 Maria Alice, A Voz Do Povo Tradisom, 1929-1931. -
MU2653 Herminia Silva, Memorias Do Fado Tradisom, 1936-1952.